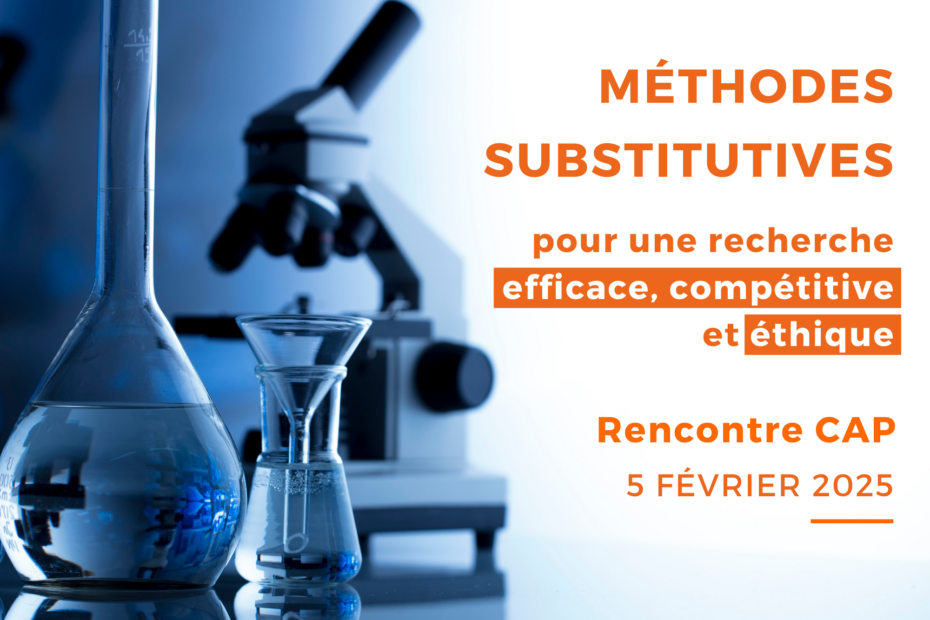Mercredi 5 février 2025, Convergence Animaux Politique a organisé à Paris sa 17ᵉ Rencontre entre ONG et parlementaires intitulée “Méthodes substitutives : pour une recherche efficace, compétitive et éthique”. Thématique rarement abordée au sein du débat public, l’expérimentation animale soulève à la fois des questions éthiques, scientifiques et économiques.
Chaque année, en France, des millions d’animaux sont utilisés dans les laboratoires à des fins de recherche biomédicale, toxicologique ou fondamentale. Nous sommes encore loin d’un modèle où le recours à l’animal serait une exception et non une norme. Pourtant, des technologies innovantes existent : les organoïdes, les modèles informatiques avancés et la bio-impression 3D ouvrent des perspectives prometteuses, non seulement pour épargner des vies animales, mais aussi pour améliorer la pertinence et la fiabilité des recherches menées. Mais leur adoption est freinée par des résistances culturelles, des contraintes réglementaires et un manque de financements dédiés. Les décideurs politiques ont un rôle fondamental à jouer dans ce changement, en encourageant des politiques publiques ambitieuses en faveur des alternatives et en renforçant les financements pour la recherche sans animaux. Pour Melvin Josse, directeur de CAP, “cette évolution ne pourra se faire sans un dialogue constant entre les scientifiques, les associations et les institutions”.
C’est pourquoi, pour la première fois, CAP a invité des scientifiques et des industriels à témoigner devant les parlementaires, aux côtés de ses ONG partenaires, afin de dresser un état des lieux des pratiques actuelles et d’explorer les alternatives permettant de concilier progrès scientifique, compétitivité de la France et condition animale.
Retrouvez ci-dessous les photos, le résumé vidéo de l’événement et les replays des deux tables rondes !
Une vingtaine de parlementaires et d’élus locaux ont assisté aux deux tables rondes organisées pour ouvrir le débat sur cette question. Parmi eux, la députée Anne Stambach-Terrenoir (LFI), les collaborateurs des députés Yannick Jadot (GEST), Charles Fournier (ECO), Marie-Noëlle Battistel (SOC) et Ersilia Soudais (LFI), les collaborateurs des sénateurs Samantha Cazebonne (RE) et Sophie Briante-Guillemont (RDSE) ainsi que les élus locaux Eddine Ariztegui (PA) et Sandra Krief (PA) respectivement chargés de la condition animale à la mairie de Montpellier et Grenoble. D’autres personnalités politiques étaient également présentes, notamment Ghalia Mercier, co-animatrice du groupe condition animale de la France Insoumise.






Table ronde n°1 : méthodes substitutives, un domaine porteur pour la recherche et pour la France ?
Animée par Hugo Marro-Menotti, responsable juridique et plaidoyer chez CAP, la première table ronde était l’occasion pour le Comité Scientifique Pro Anima et Humane Society International Europe (HSI Europe) de soulever les différents enjeux éthiques, sanitaires et économiques liés au développement des méthodes substitutives à l’expérimentation animale. Ces arguments ont pu être mis en perspective avec l’expertise industrielle de NETRI ainsi que l’analyse scientifique de Susana Gomez, vétérinaire et responsable de la formation du Groupement d’intérêt scientifique (GIS) FC3R.
Emeline Gougeon, administratrice du Comité Scientifique Pro Anima, est d’abord revenue sur les multiples limites scientifiques et économiques de l’expérimentation animale. Alors que près de deux millions d’animaux ont été utilisés à des fins scientifiques en 2022 en France, cette forte dépendance à l’expérimentation animale peut entraver les progrès dans certains domaines de la recherche sur les maladies comme le souligne la Commission européenne. Le modèle animal manque également de fiabilité, notamment pour les études précliniques. En effet, 80 à 99% des médicaments testés et approuvés chez l’animal ne sont jamais mis sur le marché car ils se révèlent toxiques ou inefficaces chez l’humain. Tous ces tests requièrent un coût scientifique et économique très élevé (le développement d’un médicament peut prendre 10 à 15 ans et coûte en moyenne 2,3 milliards de dollars selon une étude menée par le cabinet Deloitte en 2022).
Face à ces défis, Pro Anima propose la mise en place d’un fonds commun, à l’instar des Etats-Unis, qui permettrait le déploiement d’un centre dédié à la transition vers la recherche non animale conçu à l’échelle nationale avec une portée européenne.
Helder Constantino, Directeur des politiques de recherche pour HSI Europe a rappelé les progrès considérables effectués ces dernières années pour le développement de modèles et technologies plus éthiques et performantes centrés sur la biologie humaine (systèmes microphysiologiques, technologies in silico etc) afin de faire face à la multiplication des défis de santé publique (54% des décès sont dus aux maladies cardiovasculaires et aux cancer en Europe). Si l’immense potentiel de ces méthodes fait dorénavant consensus, elles sont encore peu diffusées et nécessitent d’être soutenues par des politiques publiques fortes à l’image des Pays-Bas. En ce sens, HSI Europe formule plusieurs propositions au niveau national comme européen telles que :
- la création d’un centre d’excellence dans le domaine des nouvelles approches méthodologiques (NAM).
- l’élaboration des orientations stratégiques nationales, notamment en identifiant les besoins de financements publics dans les infrastructures et la recherche.
- l’application plus stricte de la règle du « dernier recours » concernant l’utilisation des animaux dans le cadre de la révision du règlement REACH.
L’intervention de Benoit Maisonneuve, responsable produit au sein de la start-up NETRI a permis de mettre en lumière les problématiques de terrain auxquelles sont confrontées les industriels. NETRI propose des solutions d’organes sur puce et des modèles in vitro interopérables conçus pour accélérer considérablement la découverte de médicaments et les essais précliniques en imitant la connectivité neuronale in vivo dans les domaines pharmaceutiques et cosmétiques.
Le principal frein identifié est le coût élevé des études de validation. Outre le financement de ces études, le partage des données sur les résultats cliniques passés, par les agences réglementaires, fait partie des solutions identifiées pour accélérer le développement de ces innovations.
Benoit Maisonneuve a également salué les initiatives permettant de développer la collaboration entre les différents acteurs sur le territoire national, notamment la filière française industrielle des organoïdes et organes sur puces qui vise à structurer l’écosystème, engager des discussions avec les agences réglementaires et trouver des lignes de financements pour faire avancer ces technologies.
Enfin, Susana Gomez est intervenue au nom du GIS FC3R. Fondé en 2021 à la demande du ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche, ce groupement d’opérateurs de la recherche publique a pour ambition de devenir le centre de référence et point de contact en France et en Europe pour toutes les questions relatives aux 3R (Remplacer, Réduire, Raffiner). Il a pour but de favoriser la collaboration entre les différentes parties prenantes, d’accompagner les recherches utilisant des animaux à des fins scientifiques et de promouvoir des méthodes alternatives et innovantes.
D’après leur récente enquête réalisée auprès des chercheurs, les principaux obstacles pour changer de modèle sont le manque de financement, le manque de partage des ressources, puis vient en troisième position, la formation aux nouveaux modèles, car les chercheurs sont formés uniquement aux modèles animaux.
Susana Gomez a également souligné que le Groupement d’intérêt scientifique FC3R ne dispose actuellement que de 1 million d’euros par an pour soutenir l’appel à projets français, alors qu’il faudrait au moins 10 millions pour répondre aux besoins de financement des acteurs du secteur.
Table ronde n°2 : Expérimentation animale, état des lieux et perspectives
Lors de la deuxième table ronde animée par Melvin Josse, directeur de CAP, Georges Chapoutier, neurobiologiste, philosophe et directeur de recherche émérite au CNRS était présent aux côtés de nos ONG partenaires la Fondation Droit Animal Éthique & Sciences (LFDA), Animal Testing et Antidote Europe pour faire le point sur l’état actuel du secteur en France et explorer les différentes perspectives d’action.
Pour Nicolas Bureau, responsable des affaires publiques à la LFDA, de nombreux tests sur animaux continuent par ignorance des méthodes non animales existantes. La stratégie des 3R quant à elle, devrait se faire dans l’ordre remplacer/réduire/raffiner en s’assurant que le remplacement est impossible dans certains cas au regard des connaissances scientifiques (qu’il faut par ailleurs faire progresser). Le problème majeur reste selon lui le manque de moyens alloués et l’absence d’une stratégie de diffusion à grande échelle qui freine la découverte et l’adoption d’alternatives. Agir maintenant permettra à la France de devenir leader mondial en matière de recherche innovante et respectueuse des animaux. La LFDA propose plusieurs pistes d’action possibles :
- un financement public ciblé avec une réallocation des fonds favorisant les projets innovants sans recours aux animaux et un soutien aux startups innovantes.
- la création de programmes pour former aux alternatives existantes.
- la mise en place d’une base de données regroupant toutes les méthodes validées à coordonner au niveau européen.
- le développement des laboratoires dédiés à l’évaluation et à la validation des méthodes non-animales.
Pour Audrey Jougla, fondatrice et présidente d’Animal Testing, les nombreux biais de publication auxquels sont confrontés les chercheurs entraînent des dérives concurrentielles qui n’incitent pas à partager les études à résultats négatifs, nettement sous représentés aujourd’hui dans la littérature scientifique. Animal Testing propose donc de généraliser le partage des résultats négatifs. Cette demande, au-delà de réduire de façon considérable le nombre d’animaux utilisés dans la recherche, présente de nombreux avantages scientifiques et économiques en évitant la duplication inutile d’expériences testant des hypothèses déjà infirmées.
André Menache, Directeur scientifique chez Antidote Europe propose la création d’une commission d’enquête parlementaire (ou d’une mission d’information) pour questionner la validité du modèle animal de façon approfondie et obtenir des recommandations pour faire évoluer la législation et la réglementation sur le sujet.
Enfin, Georges Chapoutier, neurobiologiste, philosophe et directeur de recherche émérite au CNRS, a insisté sur la nécessité d’intégrer une dimension éthique à la formation des chercheurs. La plupart d’entre eux ne se rendent pas compte aujourd’hui qu’ils ont face à eux des animaux sentients, c’est-à-dire capable de ressentir la douleur. La perception cartésienne de l’animal-machine est encore très ancrée culturellement. Il a notamment témoigné de propos tenus au sein des laboratoires, qui illustrent l’ignorance totale des besoins fondamentaux des animaux : “pas la peine de donner à boire aux souris le samedi, puisqu’on va les tuer le lundi. »






Cette nouvelle Rencontre CAP a permis d’ouvrir un espace de débat et de dialogue sur l’expérimentation animale. Elle ouvre la voie à de nouvelles actions législatives : propositions de loi, amendements, questions au Gouvernement, création d’une commission d’enquête etc. Au-delà de l’enjeu éthique, le développement de méthodes substitutives à l’expérimentation animale sont une nécessité scientifique, sanitaire et économique pour la France et l’Europe.